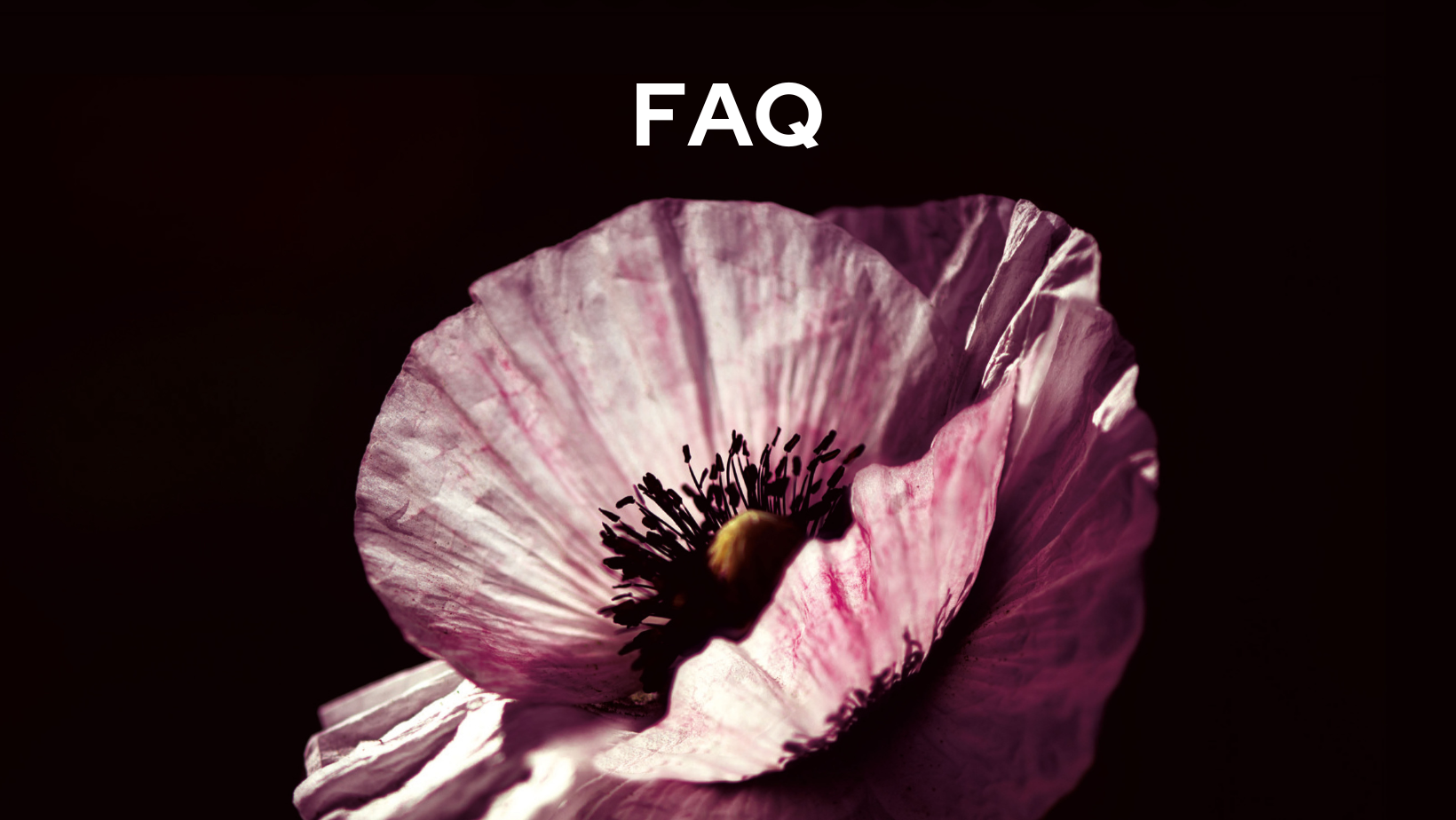FAQ Immaculée connexion
Comment le roman est-il né?
L’intrigue d’Immaculée connexion (Éditions Slatkine, août 2025) est née sur le quai d’une gare, un matin de fin d’automne, alors que mon train était très en retard. J’ai commencé à pianoter le début sur mon téléphone. Je pensais que ce texte deviendrait une nouvelle, donc un format court. Je ne pouvais pas m’arrêter d’écrire alors que j’avais très froid aux mains.
L’histoire est née du télescopage de trois idées qui m’habitent depuis longtemps: l’envie d’écrire sur quelqu’un qui s’enfuit de son travail; un questionnement personnel sur le fait que se laisser entraîner par les évènements sans faire de choix, c’est aussi un choix. Enfin, un intérêt pour l’affaire des Paccots qui, en 1985, a forcé la Suisse à se rendre compte qu’elle se trouvait sur la carte de la grande criminalité internationale : pensez donc, le 11 novembre 1985, la police fribourgeoise découvre de drôles d’armaillis qui, au lieu de Gruyère, transforment de l’héroïne!
Pourquoi ce titre, « Immaculée connexion »?
Ma première intention était de faire une allusion à la « blanche », comme on surnomme l’héroïne, et à la « French connection » ou sa variante fribourgeoise, la « Dzodzet connection ». Les mots se sont réarrangés dans ma tête et, une idée en amenant une autre, c’est devenu Immaculée connexion. Au-delà du jeu de mots, les multiples sens possibles de ce titre qui m’ont séduite. Au fur et à mesure que les lectrices et lecteurs découvriront l’intrigue, j’espère qu’elles et ils trouveront leur propre interprétation.
Pourquoi ressusciter un faits-divers datant d’il y a 40 ans?
Ayant grandi à Montreux et à Vevey, pendant les années 1980 et 1990, je ne comprenais pas pourquoi on me mettait en garde contre « les drogués » et les dealers, tout en riant à l’évocation de l’affaire des Paccots. Je percevais le comique de situation mais, en toute logique, je trouvais les agissements de ces bandits autrement plus graves que ceux contre lesquels on me prévenait. Je n’ai jamais résolu ce questionnement. Écrire ce roman a été une manière d’y répondre.
Le regard sur certaines questions de société a évolué, notamment sur les addictions. J’ai voulu en rendre compte. Il était aussi important pour moi de montrer une époque où les femmes étaient invisibilisées. Mon roman n’est pas une étude historique, puisque le crime ne dépose pas ses archives, mais il imagine ce qu’auraient pu faire alors des personnalité féminines sortant un peu des clous.
Dans ce roman, on rencontre des personnages de toutes les générations
Oui, j’ai le sentiment d’appartenir à une génération-passerelle, entre les plus vieux, celles et ceux qu’on appelle les boomers, et les plus jeunes, les Millenials. Je comprends la vision du monde des plus vieux car j’ai grandi dans une société qui vivait selon leurs règles. Et je comprends aussi les aspirations des Millénials. J’essaie de faire se rencontrer ces générations avec chacune ses valeurs et ses manières d’envisager la vie.
Retrouve-t-on les personnages de « Malatraix » et de « Dormez en Peilz »?
Immaculée connexion déroule une intrigue différente du monde de Malatraix et de Dormez en Peilz, cependant, les lectrices et lecteurs familiers de mon univers retrouveront un personnage connu, . Indice : son nom de famille est un hommage à un auteur de polars suisse romand.
Et, à l’instar de mes deux premiers romans, un animal de compagnie joue également un rôle important dans l’intrigue. C’est un personnage à part entière.
Parlons des lieux, pourquoi Vevey et les Paccots?
À quarante ans de distance, les deux lieux sont confrontés au trafic de stupéfiants, à cette économie souterraine et criminelle. Ce n’est pas le seul point commun. Même si ces deux endroits sont à cheval sur deux cantons et deux religions différentes, avec d’un côté la Veveyse fribourgeoise, catholique, et de l’autre Vevey la vaudoise, protestante, les échanges ont toujours été intenses. Cette proximité se retrouve dans l’importance des armaillis lors de la fête des Vignerons. Châtel-St-Denis est plus près de Vevey que de Fribourg…
Le texte est truffé d’helvétismes. N’as-tu pas peur que tout le monde ne comprenne pas?
Mes personnages s’inscrivent dans une réalité régionale et, pour leur donner corps, j’ai besoin que leur façon de parler corresponde à leur lieu de vie. Comme autrice, je travaille la « voix » de chacune et de chacun. Je m’amuse beaucoup à utiliser différents niveaux de langage. Oui, les régionalismes peuvent heurter un certain lectorat. À l’inverse, ils amènent du relief et vivifient la langue. Concernant mes romans précédents, des lectrices et des lecteurs français m’ont dit avoir parfaitement saisi l’intrigue tout en ayant du plaisir à découvrir de nouveaux mots et de nouvelles expressions.
L’intrigue sort aussi de Suisse.
Oui, la diversité des personnages m’a permis de faire des incursions en Italie, en Espagne et surtout en France. Les « chimistes » qui tournaient la blanche dans le fameux chalet des Paccots étaient des noms du grand banditisme français et international. Il y aurait un roman à écrire autour de chacun d’eux. Dans Immaculée connexion, ce ne sont pas ces personnalités de premier plan qui m’intéressent, même si je fais quelques allusions. Par exemple, c’est grâce au coup de filet de la police fribourgeoise que les noms des assassins du juge Michel, exécuté à Marseille, ont été connus.
Je remercie les acteurs de l’époque qui ont accepté de partager leurs souvenirs, en particulier l’ancien commissaire Michel Genoud . Ensuite, j’ai passé cette matière à la moulinette de la fiction. J’ai inventé toute une série de personnages à partir de cette matière brute. Les faits liés à l’enquête elle-même sont authentiques. Le reste est littérature.
À propos de littérature, quelles sont tes inspirations?
En Suisse romande, j’ai été marquée par les romans de Daniel Abimi et de Marie-Christine Horn. Je suis une fan de littérature noire au sens large du terme. Pour moi, Dostoïevski est un maître du thriller. J’ai de l’admiration pour des autrices et des auteurs qui ont un univers complètement personnel et qui ont su créer un monde, comme, en France, Fred Vargas ou l’extraordinaire inventivité d’un Frédéric Dard. Pour son regard sur la société, j’aime énormément ce que fait l’écossais Ian Rankin, le « père » du commissaire Rébus qui arpente Édimbourg. J’ai été plus biberonnée au polar anglo-saxon et français qu’à celui venu du nord, même si je m’incline devant Henning Mankell. Et j’avoue avoir adoré les romans-feuilletons du 19e siècle. Il m’en reste quelque chose dans la prolifération des personnages. Sinon j’ai toute une culture de « romans de gare » que j’achetais un franc chez les bouquinistes et qui étaient jugés comme de la sous-littérature. Le regard change et ces romans deviennent tendance. Publié à l’origine sous le titre « Fantasia chez les ploucs », « Le bikini de diamant » de Charles Williams a par exemple été réédité récemment. C’est un bijou de roman qui mêle noirceur et drôlerie. Et j’ai été marquée par les polars de Friedrich Dürrenmatt, en particulier « La Promesse ». Enfin, j’ai une dette envers la littérature fantastique, d’Edgar Allan Poe à Stephen King, en passant par Jean Ray et l’inimitable Terry Pratchett.